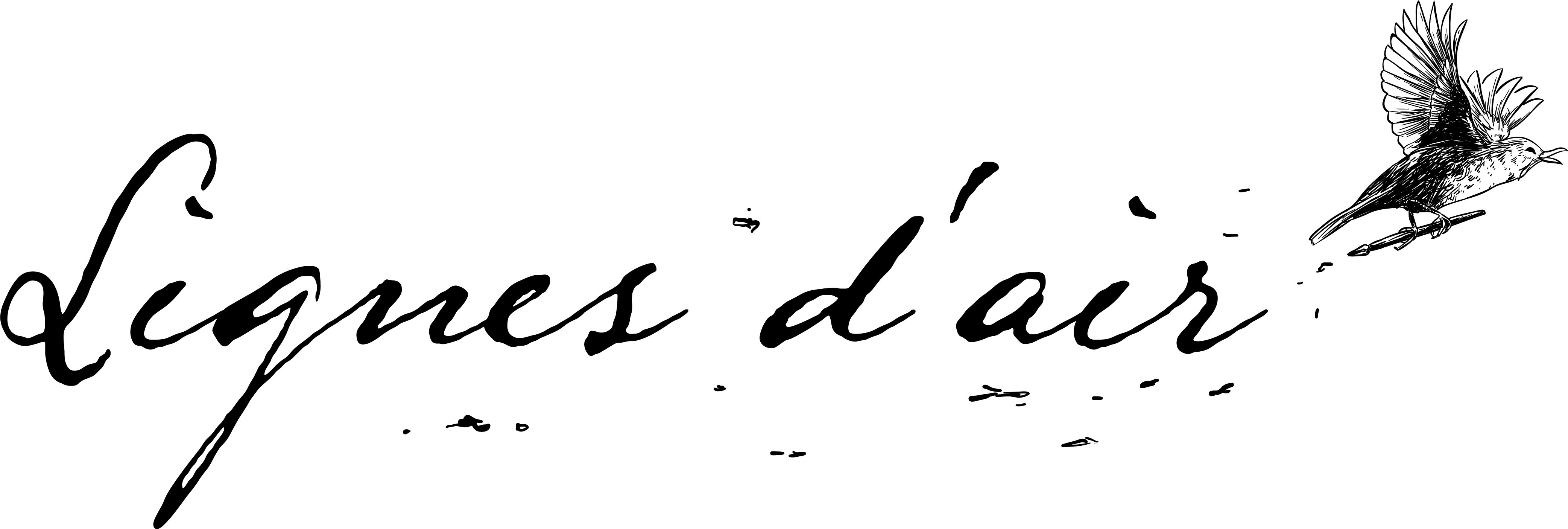Une épiphanie des arts forestiers en Matawinie
Par un beau samedi matin d’octobre 2008, avec La Traversée, nous visitons l’herbier matawin du Groupe Territoire Culturel.
Nous sommes à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, dans la pépinière de l’artiste autochtone Domingo Cisneros.
L’esprit des lieux ici sera pour moi le catalyseur d’une épiphanie joycienne.
***
…Comme Domingo possède un grand pouvoir d’évocation!
Quand il tient dans sa main la coquille pointue, grenue et poilue d’un cocon d’asclépiade, qu’il la fait éclater sous nos yeux pour en tirer une soie fine et brillante; pendant qu’il révèle qu’avec cette fibre on peut faire de la corde… il tient vraiment dans sa main une corde, et même un bouquet de cordes : écharpe, filet, lasso, lacet !
La tige de l’asclépiade devient du papier; les jeunes pousses, des asperges que j’ai envie de déguster. Puis cette découverte : tôt le matin, quand les fleurs de l’asclépiade sont encore humectées de rosée, simplement en les tâtant, on peut en tirer du miel.
En écoutant Domingo divulguer les possibilités inédites de la forêt, je me dis qu’en ne restant jamais bien loin de lui, il serait possible de m’enraciner ici. Avec patience et persévérance… je pourrais parvenir à créer la tanière de mes rêves. Une tanière qui peut devenir une taverne des plus suaves, une fois rassemblées les ivresses de la forêt. Il n’y a qu’à prendre les sentiers et cueillir la sève des bouleaux, la « sangria de arbol », comme dit Domingo. Repérer les lieux tourmentés où poussent les genévriers, récolter leurs grosses baies, les pois de trois ans, qui sont des gourdes de gin ! Trouver un beau rond d’fesse pour m’attabler. Cuisiner les fleurs de l’angelica en friandise, les beurrer avec un excellent cacao forestier de cocotte de pin rouge. Manger tout ceci avec une longue feuille mince de quenouille.
Et les arts forestiers, Domingo ? « Il faut les inventer », dit-il.
Il n’existe pas de capsule temporelle enfouie, pas de tonneau en bois de mélèze programmé pour surgir, fendre cent couches de terre et nous livrer les secrets des arts forestiers; pas de grand grimoire bucolique qui contiendrait en ses pages toutes les combinaisons possibles d’encens, de cordage, de vernis, de teinture, de peinture pour chaque espèce de bouleau, de hêtre, de merisier. Il n’y a pas de coffre de pin de Pandore pour nous révéler les centaines d’objets de nos imaginations forestières encore à déployer. C’est donc vrai : il faut tout inventer. Nous sommes dans l’aube des arts forestiers. La forêt est calme. Le brouillard s’élève. Un rêve apparaît.
Je marche avec deux torches pour m’éclairer.
J’ai une main qui serre une tête de quenouille enflammée.
Mon autre main élève une grande tige d’osier rouge chargée avec du charbon de bois de bouleau, une poudre à canon pour envoyer en l’air de petites baies.
Je cherche. Où sont les arts forestiers ?
Comment créer ?
Rêver que tout peut coller, que la bonne résine existe. Rêver de toutes les possibilités qui sont le commencement du verbe expérimenter, mais n’avoir dans ses mains aucune torche, ne serrer que quelques petits bouts de bois et les serrer fort. Tenir simplement des fleurs d’asclépiade qui ne font qu’un petit peu de miel à force d’être tâtées. Comme une abeille qui bourdonne ses idées.
Je saisis une ivresse. Je fais briller mes yeux avec un philtre d’achillée. Tiens ! Voilà une forêt que je n’ai encore jamais vue. Celle d’Alice au pays du langage matawin !
Planter des souches à l’envers, pour que leurs racines deviennent des cheveux et faire prendre du lierre là-dedans. Exposer au soleil explosant.
Suspendre des millions de pembinas en grappes à de grosses branches de pin rouge.
Faire brûler de l’huile dans des bols d’écorce de bouleau imputrescible. Passer la nuit en contemplant.
Sculpter des pièges à castors.
Poinçonner des os de maskinongés et des ravages de ouananiches en gruyère. Créer de beaux tissages.
Les poser là, cyprès, silencieux lac, calme site.
Faire une pâte à modeler avec des fleurs d’immortelle ou du fluor de ouaouaron. Grâce à cela, faire tenir ensemble des rochers tectoniques.
Wow ! Est-ce les montagnes vues du terrain de Domingo qui me donnent ce port de tête fou? Cette épinette que je fixe à contre-jour m’éblouit. Ce tronc est un axe dans l’œil, un cosmos vertical que mon regard parcourt et puis… ça vrille vers la cime qui renferme la petite bière. Selon l’herbier matawin, il y a une grande concentration de bière d’épinette à la cime de l’arbre. C’est une ivresse de plus, une ivresse de trop. Bang ! La photosphère, le sentier, le vent, l’atmosphère. Ai-je reçu une volée ou une envolée ? En tous les cas, je tombe à la renverse. Diaphane la lumière. J’ai les yeux bouche bée, ce sont des lucioles à la file indienne ? Non. Ce sont les toutes petites lumières que créent les fleurs de mousses phosphorescentes. Cette mousse existe ! Je suis par terre. J’ouvre les fenêtres du plancher de la forêt et je vois qu’ici, en Matawinie, même les os de la roche-mère, le granit, est vert! C’est foisonnant ici…
Je m’installe sur une chaise dans les branchages à la limite de la falaise. J’avale calmement l’air qu’il y a dans la photosphère entre les montagnes et moi. J’entends bien maintenant, depuis que je suis calme, ces chanteurs inlassables que sont les rouges-gorges, moineaux et parulines. Je les envie. Avec d’énormes ailes en papier d’écorce de bouleau, cousues avec des racines de cèdre, mes pieds sur de grandes échasses en bois de pin, j’aurais aimé faire un vol plané au-dessus de la falaise.
***
Mon journal de bord contient, pêle-mêle, des notes de l’herbier matawin, mes imaginations et des poèmes. Je fais des réserves. C’est un pot de noix de plus dans ma taverne d’écureuil. Je ne sais encore que faire avec ce recueil de feuilles, la forêt que ça donne, mon territoire culturel à moi. Ça pourrait pousser, prendre, germer, puisque j’ai ramassé de petites branches d’angelica, des fleurs de solidago et de petites mousses phosphorescentes. Quel bouquet ! C’est mouillé et ça donne du jus à mes pages, qui deviennent un peu plus noires, comme la terre du terroir. Je pourrais me livrer à une coupe à blanc de mes pages et faire en origami un énorme chevreuil épormyable ! ? Pour le moment, je vais continuer de jardiner la jeune forêt de mon carnet…
***
En après-midi, le temps est venu de mettre la main à la pâte forestière ! Nous apprendrons donc à connaître le solidago, qui a pour nom commun « verge d’or », et les multiples possibilités d’usage que nous consommerons toutes : onguent, teinture, argile, un vin qui goûte le lac au miel !
J’ai la main à la pâte, mais comment faire pour transformer une boule d’argile de verge d’or en pièce de poésie solide ? Cette argile n’est pas de la pâte à modeler. Je ne peux pas en faire ce que je veux. La pâte que j’ai dans les mains, faite de farine, d’alun, d’huile d’olive, d’un peu de sel, de feuilles et de fleurs de solidago passées à la moulinette est brute, granuleuse, épaisse. Pour obtenir une meilleure consistance, une personne me dit de mettre plus de farine. Une autre me dit que je dois mettre de l’eau. Une autre que je ne dois absolument pas mettre d’autre eau, mais peut-être un petit peu d’huile. Solidago est un mystère ! Domingo me dit en riant « qu’il faut travailler ». Je dois penser à cette ténacité. Solidago pousse même dans les crevasses, les cuvettes des rochers, si elles sont remplies de terre. Je dois pétrir.
Alors je pétris en espérant, en rêvant.
La pâte est calme, le brouillard s’élève, parfois une forme apparaît.
Il semble y avoir une grande loi de la nature qui régit ma sculpture : le hasard. D’accord, je fais une forme de hasard en pâte de verge d’or. Après cinq minutes de pétrissage, je peux faire une boulette. Mais je mets une heure, alors j’ai une bouteille. Aux formes difformes.
Les boulettes de solidago sont nombreuses, et je continue d’être une abeille qui bourdonne des idées.
Rien ne presse. Voilà que je n’arrête plus de pétrir, de presser, que je joue, façonne, compose.
Je fais maintenant un médaillon, tout petit, sur lequel je dispose des morceaux de bois pour faire du relief. Et puis, avec une autre boulette, je fais un cylindre brut. Simple, mais beau. Puisque c’est l’automne et qu’il ne reste presque plus de fleurs, j’y dépose un beau bouquet de branchages, de formes, de couleurs et de textures différentes. Une tige effilée comme une aiguille, brune. Une racine souterraine que j’ai arrachée d’un plant, il reste un peu de boue dessus : je la laisse là. Une tige nervurée de saillants vaisseaux de sève, du mort-bois, des brindilles picotées. Je comprends que les arts forestiers, pour commencer, il ne faut pas que ce soit plus compliqué que cela.
J’ai gardé la bouteille pour moi. J’ai donné le médaillon à La Traversée. J’ai laissé le vase aux branches multiples sur un rond d’fesse du terrain de Domingo. Pour fournir une petite contribution au projet de Territoire Culturel. Bien qu’éphémère, j’ai confiance. L’œil de la forêt aimera regarder cette empreinte agréable, une œuvre réciproque qui ressemble à la fois à un petit arbre et, avec ses branches phalanges, à une belle main qui a joué dans l’argile.
***
La région du château d’eau de la Matawinie est la scène d’une illumination décisive pour le destin des arts forestiers. Il faut se mettre au travail pour tout inventer, et, si l’œuvre n’est pas ce qu’on a rêvé, on peut toujours en faire de l’humus, des vers. Balayer ses traces avec des branches de bouleau. Éparpiller ses restes avec un petit plumeau de cèdre, comme on peut disperser des étoiles: avec de jeunes pousses d’érable argenté, bon fouet, dans la Voie lactée noire du plancher de la forêt. D’où on peut tout recomposer.
LSB, Matawinie et rue Saint-Vallier, Montréal, octobre 2008
Ce texte, rédigé suite à un atelier nomade en Matawinie organisé par le groupe La Traversée a été publié dans le carnet Derrière l’écorce, en 2009.