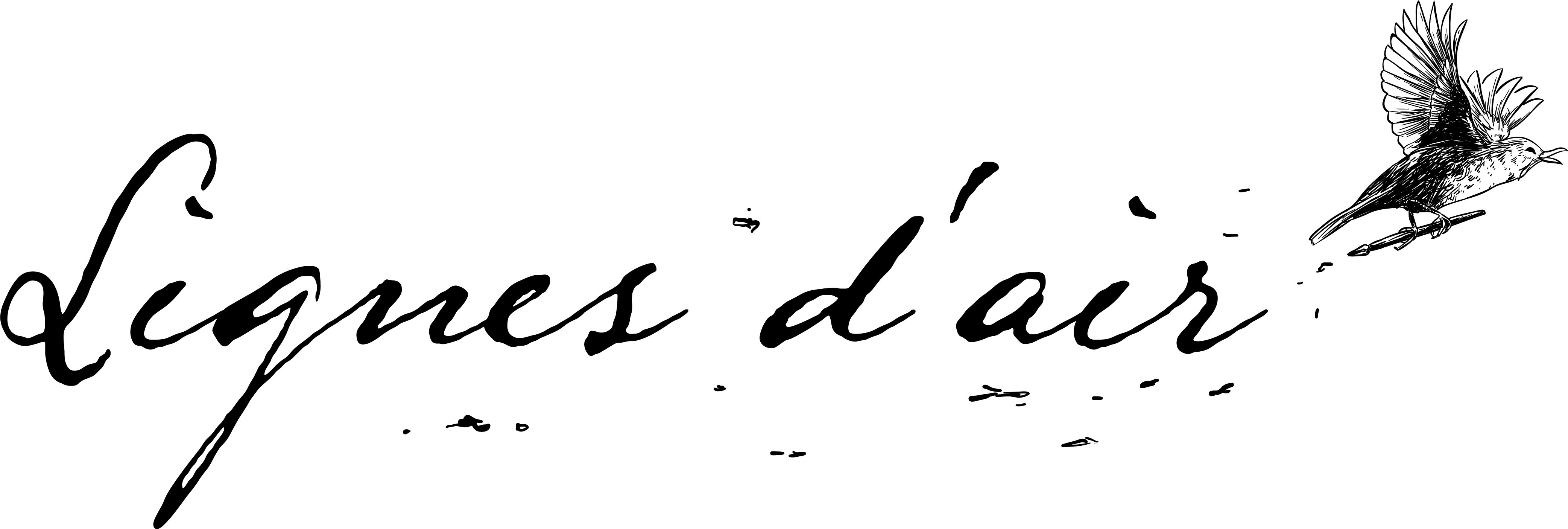Au Jardin botanique, MON saule a été coupé!
Le 16 mai, la Maison de l’arbre offrait gratuitement de petits arbres aux citoyens de Montréal afin d’accroître le nombre de poumons vivant sur notre île. Il s’agissait donc du meilleur prétexte au monde pour que je recommence à flâner au Jardin botanique, site privilégié pour apaiser le fol œil urbain en le laissant s’adonner à la lecture d’une nature luxuriante; en laissant les jambes vadrouiller à leur fantaisie en territoire alpin, jardin chinois, sous-bois, collection de lilas.
Pour accéder à la terre promise, j’ai grimpé la clôture au coin de la rue Masson et du boulevard Pie-IX. À cet endroit, la clôture du parc Léon-Provencher me va jusqu’à la poitrine et fait une perpendiculaire avec la clôture du Jardin botanique qui me va par-dessus la tête.
C’est facile d’escalader la première clôture – les larges anneaux du grillage sont un excellent marchepied. C’est comme marcher à la verticale! En m’agrippant aux branches d’un feuillu, j’arrive à me camper sur l’arête transversale de la clôture du Jardin; puis je laisse glisser de l’autre côté mes pieds dans les gros tas de compost. J’arrive dans une zone, dans le nord-ouest du parc, près de l’Arboretum, qui n’est pas révélée par la carte pourtant précise du Jardin botanique. J’arrive quelque part dans l’espace vert pâle vide de repères situé en haut et à gauche sur la carte. Mais, je vous le dis : c’est des gros tas de compost, force du Jardin, puissante genèse, foisonnante fin, qu’on trouve dans le vert tendre ici!
Cette entrée délinquante et gratuite m’excite toujours. Elle me met de belle humeur. J’aime à penser que j’ai un accès illimité au parc du Jardin botanique. Tout ce qui s’appelle parc à Montréal, qui n’est pas parc aux murs de Vincennes, se doit d’avoir un libre chemin.
Je déambule dans les forêts de feuillus, de conifères, épanouie. Les pommiers sont en fleurs, eux aussi, épanouis. À la Maison de l’arbre, j’accepte avec plaisir le cerisier tardif (p’tite jeunesse!) que l’animatrice me tend; mais, pointée dans ma direction, cette branche ressemble à une baguette de sorcier. M’a-t-elle jeté un mauvais sort? «Ben non! – que je me dis » (mais vous allez voir.)
Après ce que je considère comme les prémisses d’une excellente journée, en empruntant les sentiers sinueux et les allées de ce musée horticole, je me dirige d’un bon pas vers la zone des étangs. Ma vieille carte du Jardin botanique en mains, effritée, décolorée, gondolée d’avoir été trop longtemps serrée par mes mains trop moites, annotée de mes indications sur les tas de compost dans la zone nord-ouest – je dois encore la consulter puisque le territoire est grand et que je ne le connais pas par coeur, pour me rendre aux deux saules. L’un d’eux est devenu mon ami. Sur la carte, les deux boules près de l’étang me sourient.
Cette aire de détente est l’endroit au Jardin qui ressemble le plus à un parc. Des couvertures s’allongent sur le parterre, les gens s’arrêtent de marcher, s’assoient et sortent des livres. Il y a une cabane à oiseaux dans l’eau sur un piquet qui indique que le fond de l’étang n’est peut-être pas aussi vaseux que ça en a l’air. J’ai toujours été fascinée par les milieux humides. Je ne suis pas la seule. L’eau apaise. Les étangs, c’est le plus grand point d’eau du Jardin. Avez-vous remarqué combien les gens ont tendance à retourner aux mêmes endroits? Dans les parcs, les aménagements deviennent comme des meubles commodes à la flânerie. Les rochers deviennent des chaises, les branches des cordes à linge, le couvert des arbres des parasols. Une des deux petites niches des saules est ma maison, mais c’est sûrement aussi la demeure de flâneries de beaucoup d’autres personnes…
À mon arrivée, je suis commotionnée. Un des deux saules pleureurs, MON saule pleureur, a été coupé, fendu, haché. Il ne reste plus que le tronc nu, moignon incongru, baignant dans une mare de bran de scie; les restes d’un carnage, d’un massacre à la tronçonneuse. J’ai le goût de pleurer!
LES IMMONDES, ILS ONT ÉMONDÉ MON SAULE!
Un gros cri que je n’ai pas poussé.
Je m’assois sur le cœur de l’arbre. Le miroir des eaux ne reflète plus les branches de mon saule. Ça me saisit, je me relève aussitôt et je me pose sur le banc. Le soleil tombe à pleine livrée sur mes épaules. L’ombre ici, c’était la présence du saule. Un écho du banc, un vieux souvenir m’envahit. «Hé ! Regarde ! On se fait piller !» «Beurk ! C’est plein de bave d’écureuil sur ma boîte de noix !».
J’avance, je recule, je tourbillonne. Tu taches le paysage. Près des berges : des brins d’herbe mnémotechniques. Mêlés dans la pelouse, des excréments de canards. J’ai longtemps essayé de les attraper, t’en souviens-tu? « Hihihi, tu seras pas capable ! » De la boue. Est-ce mon empreinte, notre trace? Cette fois-là qu’on était restés tellement longtemps à grouiller du yoga ensemble que j’avais écrit dans mon journal « à force de se retourner au même endroit dans l’herbe trempée, à l’ombre, cela a fait une flaque de boue ».
Je fais nerveusement le tour du tronc coupé du saule. C’est impudique de voir la vie de son arbre à nu comme ça, en livre ouvert. Je suis trop affolée pour être capable de lire. Mes yeux glissent du tronc vers ma branche de cerisier tardif grosse comme un crayon à mine. Fragile comme une mine de crayon : mon nouvel arbre!
Je retourne chez moi illico : j’ai un arbre, une mine de crayon, à planter.
***
Je suis retournée au Jardin botanique le 14 juin avec l’intention de mener ma petite enquête sur la mort du saule. Je n’étais pas calme. Pourquoi les gens du Jardin botanique avaient-ils coupé ce saule? D’habitude, ils ne coupent pas les arbres sans raison. Je n’en voyais qu’une : l’arbre était probablement malade. Un champignon ou quelque chose comme ça. J’ai ouï-dire d’une maladie des saules. Je suis retournée au Jardin pour inspecter le tronc coupé, prendre des photos et les envoyer à un ami qui a étudié en foresterie et qui aurait pu m’aider à élucider le «POURQUUUOOOIII ? » que je me pose.
Lorsque j’atteins la zone des étangs : j’aperçois un chantier de construction! Tiens, encore des bouleversements! Je n’ai pas besoin d’aller scruter les courbes ligneuses de mon saule pour comprendre pourquoi il a été scié. Voilà, il a été scié pour cause d’habitation humaine! Ah! C’est ironique! Oui, oui. Ici, on construit.
De minces planches de bois franc s’érigent et forment le squelette d’un nouveau pavillon, un carcan qui entoure le deuxième saule, encore debout celui-là; mais si ça continue, ça pourrait bien l’étouffer, s’ils ne le coupent pas lui aussi. Je ne pense pas que les gens du Jardin botanique vont le laisser au milieu du bâtiment, continuer à prendre racine sous le plancher, ses branches nues se baigner dans le soleil au travers du toit.
Le paysage aussi a subi des rénovations. Le niveau de l’eau a monté. Le banc a été enlevé. Il n’y a plus aucun canard. Tiens, voilà un endroit que je n’avais jamais vu. Un endroit où je ne suis jamais venu. Un endroit où je n’ai pas de souvenirs. Je regarde les étangs. Le miroir des eaux ne reflète plus les branches du deuxième saule, il reflète des planches de bois franc. Je voudrais faire disparaître ce triste miroir. J’ai soif. Je pourrais boire l’étang, mais je sais qu’en dedans, ça n’arrêterait pas de grenouiller.
Je sursaute, sort de la torpeur dans laquelle ce site inconnu m’a jeté, tourne les talons et retourne chez moi.
***
Après ces deux sorties déroutantes, je ne suis plus certaine que le Jardin botanique sera un lieu où j’irai beaucoup cet été. J’y ai attrapé, en cette fin de printemps, une agitation difficile à nommer. Il y a un mouvement qui m’a pris depuis que j’ai été déraciné.
J’ai écrit à mon amie J. pour lui faire de part de mon témoignage sur la mort du saule. C’était nécessaire que je partage cette histoire avec elle puisque c’est elle qui m’a fait escalader pour la première fois la petite clôture du parc Léon-Provencher ; qui m’a pris par la main quand j’ai atterri dans le compost. C’est elle qui m’a présenté au saule du Jardin botanique. C’était NOTRE saule.
Elle m’a réécrit pour me rappeler le poème qu’elle m’a lu la première fois qu’on y était allées ensemble , par une journée d’automne.
«Organic matter all over
Whispers spread as prayers
To forgive and forget
To learn to let it go »
On avait décidé alors que cet endroit sous le saule serait un passage obligé dans un rituel pour nous aider à passer au travers des petits deuils de la vie. To learn to let it go. Avec les moments de plaisirs qui s’étaient accumulés depuis cette toute première fois, j’avais complètement oublié.
Cet été, je sens que je pivote, que je toupille, plus que je ne flâne. Mes jambes sont comme des ressorts, j’ai des gornouilles dans les mollets. Mon corps n’est plus posé. J’ai de la misère à m’asseoir et à m’imprégner de quelques endroits que ce soit. Je voudrais bien me laisser prendre, me laisser accueillir, mais c’est difficile . Cependant, je continue à marcher, à me promener dehors, à faire des allées et venues, en radar tête chercheuse que je suis devenue. Kaléidoscope-misanthropique, je pratique l’auto-stop-spot du mieux que je le peux. J’ai les yeux télescopiques à force de décomposer les parcs. J’attrape des flashs – peut-être que je flâne trop avec mon appareil photo. Je manque d’un endroit où ancrer mon corps, sans plus, pour bien regarder.
LSB, Saint-Vallier, Montréal, mai-juin 2009Ce texte a été publié par votre serviteure en premier lieu sur le site web de La Traversée, l’Atelier québécois de géopoétique, dans le cadre de la saison de flânerie Parc et Square, à l’été 2009.